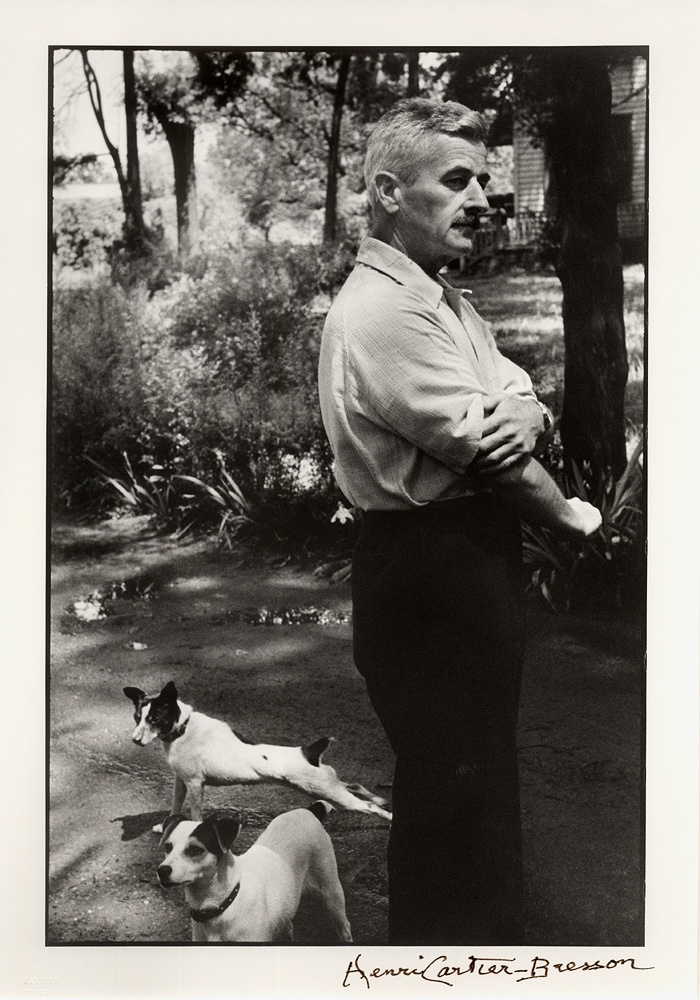|
Faulkner,
c'est leur patron Par Pierre
Assouline William
Faulkner est, pour beaucoup d’écrivains français, le romancier absolu.
Alors
que paraît en Pléiade un nouveau tome de ses romans, Pierre Assouline
mène
l’enquête Faulkner, le
patron? En France, du moins. Il est rare de ne pas entendre un hommage
appuyé
dans la bouche de nos écrivains ou de ne pas découvrir une
reconnaissance de
dette sous leur plume. Mais il n’y a rien de réducteur à l’évoquer
comme «un
écrivain pour écrivains» puisque, après tout, ce sont eux qui font
passer les
livres. Faulkner
a eu le génie de rendre son coin de
terre universel. Le monde réduit à un petit contenu. Pour avoir un jour
croisé
Patrick Besson dans un train plongé dans «Absalon, Absalon!», un
exemplaire de
«Monnaie de singe» dans la poche, j’ai vite compris que c’était son
Dieu:
«Faulkner, c’est Balzac à la campagne: la chair, la terre, tout est
très
concret et matérialiste et en même temps spirituel. Je l’ai découvert
sur le
tard, à 45 ans; j’étais fait. Heureusement: il est impossible d’être
influencé
par lui et de s’en sortir. C’est le plus grand écrivain du monde.»
Besson ne
croit pas si bien dire puisqu’on sait de l’aveu même de William Styron
qu’il
écrivit «la Marche de nuit» pour se désenvoûter de l’influence que le
génie
faulknérien exerçait sur lui. Angelo Rinaldi reconnaît avoir retrouvé
sa Corse
natale dans l’âpreté de ce Mississippi. «Alcool, brutalité, sensualité
refoulée, tout est dans "Lumière d’août", l’un des plus grands romans
jamais écrits», estime-t-il avant de louer dans «les Palmiers
sauvages»,
«formidable tout en étant raté», la scène inoubliable au cours de
laquelle les
deux amants partagent une boîte de haricots. Ce
que lui doit Patrick Chamoiseau? Une
paille. Ecoutez plutôt: «Que la réalité est intransmissible, que les
mots ne
transmettent rien, que l’incertitude est la seule base qui tienne, que
la
matière humaine est une pulsation de conscience dans un chaos de haute
complexité, que dévoiler n’est pas mettre à plat, ni raconter mais
éclabousser
d’ombres et d’éclats qui ouvrent toutes les portes mais ne se donnent
pas, et
qu’alors il nous reste la matière démesurée du langage et l’infini
courage à
mettre en œuvre pour tenter d’en faire un événement, c’est-à-dire de la
littérature.» Les romans de Faulkner ont agi à la fois comme une
épreuve et un
stimulant pour Tahar Ben Jelloun, «le Bruit et la Fureur» notamment,
histoire
qui suscite le malaise dès lors qu’on la sait racontée par un idiot, ce
Benjy
qui voit le monde avec stupeur et naïveté ; un roman au climat lourd et
touffu,
difficile d’accès car oppressant jusque dans sa manière d’exprimer
l’inexprimé.
«Un roman qui a exigé tant de travail et d’effort de son auteur, lequel
n’a
jamais été satisfait du résultat, devrait être lu et médité par tout
écrivain,
dit Ben Jelloun. La littérature n’est pas une reproduction du réel mais
une
invention d’un réel invisible. La littérature de Faulkner, dont
l’apport est
équivalent à celui de Joyce, produit une puissante réalité dont
l’humanité est
immense et la souffrance, profonde. Alors oui, je lui dois énormément.»
Il
n’est pas jusqu’à Malraux qui crût distinguer au fil des pages de
«Sanctuaire»
l’intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier. Certains
écrivains français ont signé leur reconnaissance
de dette sous forme de livre à lui consacré. C’est le cas de Pierre
Michon: «Il
me semble que pour un écrivain rien n’est plus intime, rien ne le
constitue
davantage, rien n’est plus lui-même, que cette volonté énonciative dont
j’ai
parlé, ce désir violent qui préside à sa phrase, cet infime et décisif
putsch
dans son parlement intérieur, qui fait soudain que la voix despotique
de ce
qu’on appelle, et qui est, la littérature, se met à parler à sa place.
C’est
cela que j’appelle Faulkner.» Cette certitude est au cœur de «Trois
Auteurs»
(1997) et de «Corps du roi» (2002), même si elle irradie toute son
œuvre.
Michon a été jusqu’à identifier sa propre biographie à celle de
Faulkner en
établissant des passerelles entre les accidents de leur vie: origines
sociales,
roman familial, alcoolisme autodestructeur… Il a fini par décalquer sa
Creuse
sur le comté de Yoknapatowpha. Il ne sait pas au juste pourquoi il a
été à lui
mais il y va encore, captivé par une force d’attraction qui le dépasse,
persuadé
avec Borges qu’on ignore ce qu’il y a au fond de ses livres, même si on
sait
juste qu’y gisent des vérités qui nous terrorisent. Il est lui aussi
l’écorché
au seuil de sa maison de douleur. Lui aussi veut accepter d’être dans
le
mouvement du monde. Faulkner n’est pas son Dieu mais son roi, un génie
dans son
genre, le romancier capital, celui qui aura marqué «la» rupture
littéraire de
son siècle. Son ami Pierre Bergounioux n’en est pas très éloigné, lui
qui a
fait du grand Américain une figure tutélaire de son œuvre, comme en
témoigne
son «Jusqu’à Faulkner» (2002). Son
essai n’a pas toutefois la proximité avec
son sujet qu’a pu entretenir Edouard Glissant en s’immergeant en
Louisiane pour
y enseigner et écrire son «Faulkner, Mississippi» (1996). En totale
complicité
avec cet autre écrivain des plantations, il y mettait en lumière son
sens de
«la révélation différée», cette vérité exprimée par éclipses mais
jamais
vraiment formulée. En 1958 déjà, en recevant le prix Renaudot, Glissant
en
profitait pour rendre hommage à Faulkner, à son génie déployé dans
l’imbrication des personnages et à sa capacité à dévoiler l’opacité
d’une
situation en poussant le lecteur aux dernières marches du vertige. Sa
vie fascine autant que son œuvre. Sauf que
contrairement à la plupart de ses romans, que tout nouveau lecteur juge
de
prime abord difficiles, voire incompréhensibles, sinon illisibles, la
mosaïque
de sa biographie n’est pas si indéchiffrable. Arriviste, ambitieux,
petit,
économe, bûcheur et alcoolique comme ce n’est plus permis.
L’iconographie
ajoute à la légende: vestes de tweed, pantalons de velours, pipe au
bec,
élégance délicieusement patinée de gentleman sudiste rehaussée par une
fine
moustache. Henri Cartier-Bresson fixa pour l’éternité cette image en
1947, chez
lui, à Oxford, Mississippi, campé en fermier à la retraite, les chiens
à ses
pieds. Faulkner le mythomane y est saisissant de vérité. On l’entend
presque
dire ce qu’il a effectivement dit à son portraitiste: «La littérature,
c’est
très bien, mais l’agriculture, c’est le grand truc.» Des photos qui
contribuèrent à forger la légende. Ils se retrouvèrent à l’été 1962 à
l’Académie militaire de West Point par l’un de ces hasards objectifs
chers à
l’ancien surréaliste : Cartier-Bresson tenait absolument à écouter le
discours
que l’écrivain devait prononcer devant les élèves officiers; c’était
une
occasion de le photographier en queue-de-pie, le prix Nobel ayant même
eu la
coquetterie d’y accrocher sa rosette de la Légion d’honneur. Après
avoir lu un
extrait des «Larrons» dont il venait d’achever la rédaction, il réussit
la
prouesse de blâmer la guerre tout en louant l’armée: «Monsieur
Faulkner, y
a-t-il un rapport entre les militaires et la littérature? – S’il y en
avait un,
il n’y aurait pas de littérature.» Un triomphe. Ces photos furent les
dernières: trois mois après, il était mort. La
fascination qu’exerce Faulkner sur les
Français est d’autant plus remarquable qu’elle semble inversement
proportionnelle à son destin américain. Alejo Carpentier, Gabriel
Garcia
Marquez, Kateb Yacine et d’autres encore à travers le monde ont exprimé
leur
admiration pour Faulkner, mais combien d’écrivains américains ont
récemment osé
ou osent encore le faire à part William Styron (l’un des rares
étrangers à la
famille admis à son enterrement), E. L. Doctorow et Cormac McCarthy ?
Le
journaliste de «Newsweek» Christopher Dickey se souvient que son père,
le poète
James Dickey, lui disait: «Les bouquins de Faulkner sont épuisés: ce
sont des
profs qui lui ont donné son prix Nobel!» Alain Mabanckou, qui enseigne
à Ucla,
est d’avis que l’influence de Faulkner se fait désormais sentir
essentiellement
chez les écrivains afro-américains, une Toni Morrison, par exemple, qui
lui
doit, d’après lui, sa manière d’enchevêtrer les personnages. N’empêche
qu’il fut en son temps la référence,
que ses romans sont toujours au programme de la plupart des collèges et
que sa
technique est étudiée dans les ateliers d’écriture. Ce qui est bien le
moins.
Peut-être Faulkner a-t-il disparu du paysage littéraire américain en
même temps
que sa génération alors que la France ne l’a jamais démodé; elle est
restée
insensible au «moment Faulkner» pour le faire entrer très tôt au rayon
envié
des écrivains universels et intemporels, en dépit d’un certain mépris
affiché
de ses compatriotes, et d’une critique américaine qui l’a longtemps
traité
par-dessus la jambe. A croire que la France a rattrapé Faulkner, comme
elle
fait depuis avec Paul Auster et Woody Allen, plus appréciés chez nous
que chez
eux. Il
serait injuste de ne pas rappeler ce que
les lecteurs français doivent aux grands faulknériens de la traduction
et de
l’édition critique, R. N. Raimbault, Michel Gresset, François Pitavy,
Didier
Coupaye, Alain Geoffroy, Jacques Pothier et André Bleikasten qui publie
ces
jours-ci une remarquable biographie de Faulkner (1), nourrie par une
longue et
intime fréquentation de l’œuvre et servie par une écriture chaleureuse.
Sans
ces discrets passeurs, l’influence de Faulkner sur notre littérature
serait
moindre, les écrivains français n’étant pas du genre à lire les romans
étrangers dans le texte, sauf exception. On
allait oublier l’indispensable Valery
Larbaud, qui révélait l’obscur génie de cet inconnu en déplorant que la
librairie osât ranger «Tandis que j’agonise» au rayon «romans paysans».
Et
Maurice-Edgar Coindreau, bien sûr, le traducteur en titre, moins
accidentel que
le poète André du Bouchet à qui l’on confia autrefois «le Gambit du
cavalier».
Le grand Coindreau fit connaître le nom de Faulkner par un article
publié en
1931 dans «la Nouvelle Revue française». Il fut l’un des tout premiers,
sinon
le premier, à être fasciné par la puissance de ce solitaire qui avait
su créer
un monde et qui y vivait. Interrogé par Christian Giudicelli au micro
de
France-Culture sur l’influence de Faulkner parmi les romanciers de la
jeune
garde, le vieux traducteur réfléchit un instant et murmura simplement :
«Il est
là.» Puis, après un temps, il se reprit et ajouta: «… et il y restera.»
Plus de
quarante années ont passé depuis mais c’est toujours vrai. Faulkner est
là. P.A. «Œuvres
romanesques, tome IV», par William Faulkner, Gallimard, «La Pléiade», 1
472 p.,
77 euros (prix de lancement : 69 euros). «Les
Snopes», par William Faulkner, Gallimard, «Quarto», 1 350 p., 28 euros.
(1) «William
Faulkner. Une vie en romans», par André Bleikasten, Editions Aden, 733
p., 38
euros. Source : «Le
Nouvel Observateur» du 13 décembre 2007 |